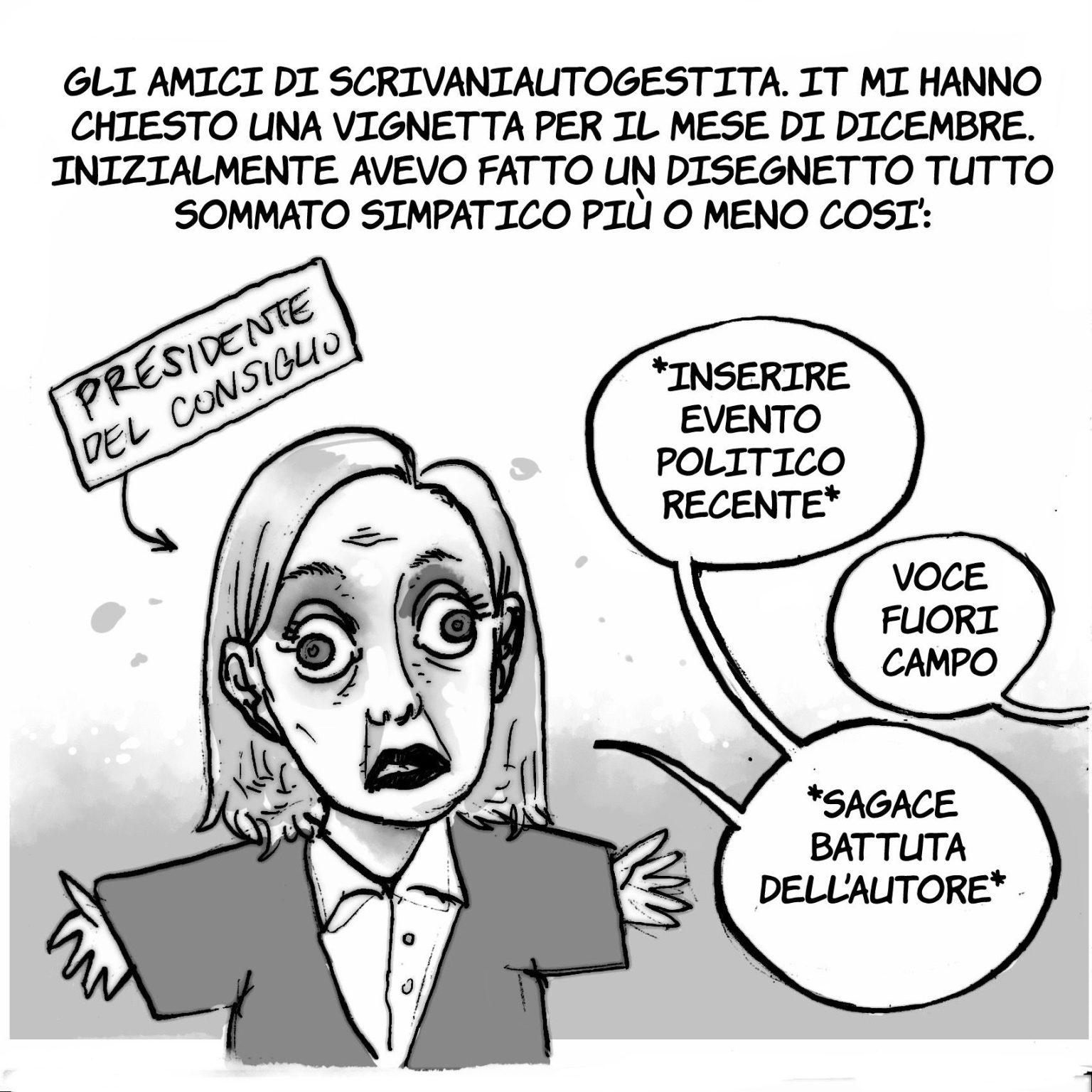Réflexions à chaud sur le mouvement « Bloquons tout »
Il est presque impossible de dresser un bilan organique de ces journées incroyables. Le mouvement « Bloquons tout » a représenté une véritable rupture politique et sociale dans l’histoire italienne.
Des millions de personnes dans les rues à travers toute l’Italie. Deux grèves générales effectives en l’espace d’une semaine, des cortèges spontanés, des blocages diffus partout et une composition si hétérogène et transversale qu’il est difficile d’en trouver un équivalent dans le passé récent. Le mouvement « Bloquons tout » a, en quelques jours, traversé tous les secteurs sociaux de notre pays — des prisons, où certains détenus ont fait grève, jusqu’aux ambassades italiennes à travers le monde. Et potentiellement, sous certaines conditions, les possibilités d’une généralisation encore plus large existeraient. Le mouvement pourrait encore croître dans des territoires et des secteurs sociaux peu touchés par la politique, qu’elle soit institutionnelle ou issu des mouvements autonomes.
La dynamique qui s’est activée grâce à la générosité des militants et militantes de la Global Sumud Flotilla, à la détermination des dockers du CALP et à la vigueur du syndicalisme de lutte est en train d’influencer tout le cadre politique italien et européen. Peut-être même celui mondial. Sans se faire trop d’illusions, le calendrier du Plan Trump suggère que la montée de l’indignation de l’opinion publique contre le génocide du peuple palestinien a joué un rôle loin d’être marginal. D’ailleurs, pour ceux d’entre nous qui continuent à réfléchir aux leçons de l’opéraïsme, la chose n’est pas si surprenante : le capitalisme et ses formes institutionnelles se restructurent aussi sous l’impulsion des luttes sociales — même lorsque les mystifications capitalistes ne permettent pas d’en percevoir clairement le lien de causalité.
L’accélération à laquelle nous assistons n’a pas de précédent historique récent, et elle diffère considérablement d’autres cycles de mobilisation, pourtant de masse et transversaux, mais qui avaient des caractéristiques bien codifiées dans les traditions des mouvements sociaux.
Il faut assumer pleinement ce constat. Reconnaître la césure historique et comprendre que les foules ont largement dépassé les capacités organisationnelles des structures militantes, bien que celles-ci aient joué un rôle loin d’être secondaire en permettant la création de cette alchimie. C’est un débat qui nous concerne directement et nous traverse — et pour lequel nous n’avons pas de solutions déjà prêtes. Nous essayons d’exprimer ici quelques thèses inorganisées et provisoires, toutes à vérifier sur le terrain.
1 – Quelque chose de totalement différent
Depuis la crise de 2008, nous pouvons identifier trois cycles de mobilisation sociale dans notre pays, très différents les uns des autres. Chacun de ces cycles a eu des caractéristiques spécifiques en termes de composition sociale, de dimension organisationnelle et d’expression politique. Le premier a été essentiellement de nature résistante : les mobilisations contre la réforme Gelmini, contre le gouvernement Berlusconi d’abord, puis contre celui de Monti ; les manifestations contre l’austérité et le mouvement Occupy à l’italienne ont constitué, en substance, la réaction de divers secteurs sociaux face à la perspective d’un appauvrissement de masse, d’une prolétarisation — en d’autres mots, à la fin des perspectives ascendantes.
Dans ces années-là, entre les écoles et les universités, mûrissait la première génération qui n’atteindrait pas le niveau de bien-être de ses parents. Les formes politiques et organisationnelles de ces mouvements reflétaient cette tension : malgré certains éléments de nouveauté empruntés à d’autres pays — comme les acampadas — les mobilisations sociales restaient assez semblables à celles qui avaient caractérisé le long 1968 et surtout les années 1990. Ce fut un cycle qui, malgré sa puissance, a marqué la fin de cette phase historique.
La période suivante a été marquée par ce que nous avons défini comme la mobilisation néopopuliste, tant sur le plan électoral que dans la rue. L’ascension puis l’effondrement du Mouvement 5 Étoiles se sont accompagnés de phénomènes sociaux ambigus et hybrides, présentant toutefois certaines constantes. D’un côté, une direction « politique » des mobilisations assurée par une classe moyenne en voie d’appauvrissement ; de l’autre, une composition extrêmement hétérogène qui juxtaposait ses propres revendications à celles des promoteurs des manifestations, même lorsqu’elles étaient objectivement contradictoires, au nom de la nécessité d’un changement jugé commun et indispensable. En Italie, cette tendance a caractérisé de nombreux phénomènes : des Forconi1 , aux mobilisations des agriculteurs, jusqu’au mouvement contre le Green Pass2. Des intérêts et des attentes différentes fusionnaient pour exprimer un rejet de l’état des choses, rejet qui restait inévitablement générique dans la forme de l’agitation, mais spécifique dans les plateformes portées par les secteurs sociaux « moteurs » des manifestations — du moins à leurs débuts. Que ces phénomènes puissent aller vers un processus de « clarification » des intérêts en jeu, nous l’avons vu pour la première fois avec les Gilets Jaunes en France.
Avec ses spécificités, peut-on penser que « Bloquons tout » soit le « moment Gilets Jaunes » italien ? Oui et non. Oui, car il y a une similitude du point de vue de la composition sociale, des pratiques de lutte et aussi de la capacité d’influencer le cadre institutionnel (sur lequel nous reviendrons). Non, car à certains égards, « Bloquons tout » représente un stade de maturation plus avancé des subjectivités. Au-delà du rôle déjà mentionné des forces sociales organisées, il faut prendre en compte la conjoncture politique générale : le « régime de guerre » naissant, la montée au pouvoir, à l’échelle mondiale, des droites souverainistes, l’approfondissement de la crise sociale et économique contribuent à changer la direction du vent. Nous sommes face à quelque chose de nouveau, chargé de potentialités.
2 – Le drapeau palestinien
À juste titre, beaucoup ont mis en garde ces dernières semaines contre les tentatives de dissocier cette mobilisation surprenante de ses causes évidentes.
Le génocide du peuple palestinien a sans aucun doute été le déclencheur émotionnel de ces manifestations. Ce fut une expérience de douleur et d’impuissance partagée pendant presque deux ans : les images provenant de la bande de Gaza nous ont confrontés, à plusieurs reprises, à divers dilemmes. Pouvons-nous continuer à mener une vie « normale » alors qu’en face, de l’autre côté de la Méditerranée, se déroule une épuration ethnique ? Pouvons-nous accepter que les institutions qui nous gouvernent permettent cela sans rien dire ? Chaque jour, depuis deux ans, ces questions nous hantent — au travail, à l’école, à l’université, au café, dans le silence de nos maisons. Alors que les télévisions, les journaux et les politiciens répétaient en boucle les pires narrations du régime sioniste, nous nous rendions compte que nous n’étions pas seuls à nous poser ces questions. Malgré la propagande de guerre obsessive, de plus en plus de gens se sont libérés de la peur de contester : depuis un certain temps déjà, les initiatives de soutien au peuple palestinien ont dépassé les milieux sociaux traditionnellement les plus sensibles à ces thèmes — les jeunes et les communautés arabes en Italie.
Sit-in, initiatives et cortèges ont vu la participation croissante de secteurs de la société qui ne s’étaient plus mobilisés depuis longtemps. À mesure que la demande adressée aux institutions — qu’elles sortent enfin de leur inertie et de leur complicité avec Israël — restait sans réponse, la confiance dans la rue comme espace où compter réellement grandissait.
La narration médiatique a progressivement changé : de plus en plus de personnalités publiques ont été contraintes de se prononcer, bon gré mal gré ; les universités ont dû se justifier. La Global Sumud Flotilla a représenté un tournant, car elle a offert une réponse pratique à une autre question que beaucoup d’entre nous se posaient : « Comment pouvons-nous changer les choses si notre gouvernement, et plus généralement les institutions de notre monde, ne nous écoutent pas ? » En prenant l’initiative, en cessant de déléguer. Ce geste courageux de l’équipage de la Flotilla a brisé la défiance. Il a démontré qu’une partie de la société peut s’organiser pour briser l’inertie du génocide, même si aucun gouvernement n’est disposé à le faire.
Certes, cette dynamique émotionnelle a joué un rôle fondamental dans la naissance du mouvement. Mais il ne faut pas sous-estimer d’autres aspects importants. En premier lieu, celui du « savoir ». S’il y a quelque chose de surprenant — depuis les camps de tente à l’université — c’est bien à quel point cette mobilisation a été accompagnée par des formes d’apprentissage par le bas, partagées et collectives. Nous avons souvent été étonnés, même en dehors des manifestations, de découvrir combien la connaissance — non superficielle — des causes, de l’histoire et des visions de la lutte de libération palestinienne s’était diffusée au-delà même de ceux qui se mobilisaient directement. Autour de ces luttes s’est construit un savoir à la fois général et spécifique, transversal et enraciné, complexe et raffiné. Inévitablement, ce savoir, en partant de la question palestinienne, a dû se confronter à toute une série d’autres problématiques : le fonctionnement des universités italiennes, la logistique de guerre, le rôle stratégique de l’Italie, des États, des multinationales, le fonctionnement des médias, le droit international, l’histoire du colonialisme, et mille autres aspects encore. Tout cela s’est produit sans qu’il soit besoin d’évangélisateurs allant de maison en maison : c’est le fruit d’une intelligence collective confrontée aux défis d’une mobilisation de masse. On pourrait s’interroger sur le rôle des réseaux sociaux et sur le fait d’avoir en permanence une encyclopédie potentielle dans sa poche, mais ce n’est sans doute pas l’aspect le plus important aujourd’hui. Ce qui importe de dire, c’est que la mobilisation en solidarité avec le peuple palestinien a constitué un véritable cours accéléré sur le fonctionnement de nombreux aspects de notre monde, souvent dissimulés sous la couche de mystifications produites par le capital. Une prise de conscience qui, forcément, ne concernera pas seulement le rôle de notre pays dans le génocide.
À première vue, cela peut paraître paradoxal, mais la complexité et la profondeur historique de la question palestinienne n’ont pas entravé le développement du mouvement — au contraire, elles en ont été la force, permettant à chaque fois de gravir un niveau supplémentaire de réalité à affronter. Ce fut aussi un processus de libération en ce sens : la conquête d’une connaissance autonome des rapports sociaux mondiaux. C’est une leçon importante : penser qu’il existe une séparation trop déterministe entre le champ des besoins matériels et celui du politique est une vision superficielle, voire parfois classiste.
D’ailleurs, s’il est peut-être exagéré de ressortir l’ancien slogan « Le Vietnam est à l’usine », il n’est pas absurde de penser que les conditions matérielles vécues par une partie significative de notre pays ont joué un rôle dans ce processus. La logique du réarmement et de l’économie de guerre rencontre un refus diffus et transversal, déjà apparu à d’autres occasions. Plus généralement, il est raisonnable de penser qu’un ensemble de revendications, n’ayant pas trouvé de formes d’expression propres, se sont déversées dans les manifestations pour Gaza comme symbole d’une libération face à un système injuste et de plus en plus oppressif. En particulier parmi les jeunes générations, on observe la projection d’une expérience sociale marquée par l’effondrement croissant des attentes d’amélioration des conditions de vie et par la réduction des espaces de liberté. Comme nous l’avons souvent dit : une forme possible de nouvel internationalisme.
Cela ne signifie pas que les personnes participant à ce mouvement s’engagent immédiatement sur d’autres terrains — tels que le réarmement ou les besoins sociaux. Mais cette mobilisation ouvre des espaces de possibilité sous plusieurs angles. D’abord, elle montre que descendre dans la rue est une manière effective d’influer sur les phénomènes politiques nationaux et internationaux. Ensuite, elle met en évidence l’existence d’une majorité sociale potentielle réticente à se rallier à l’armée — réelle ou métaphorique — du capitalisme occidental dirigé par les États-Unis.
3 – Temps additionnel
L’aspect peut-être le plus surprenant de cette dynamique est qu’elle s’est déclenchée de manière totalement indépendante des partis et des syndicats de la gauche institutionnelle. Le geste de la CGIL, qui a lancé une grève quelques jours avant le 22 septembre3, s’est retourné contre elle, démontrant que le syndicat n’est plus en mesure de saisir la profondeur du malaise social. Le choix, en rattrapage, de s’unir à la grève générale du 3 octobre a replacé Landini au centre de l’attention. D’un côté, cette décision a probablement mûri sous la pression des adhérents du syndicat et a facilité un élargissement de la participation — également grâce à l’hystérie du gouvernement ; de l’autre, elle constitue une tentative de ramener la protestation dans le giron institutionnel. Il en va de même, en partie, pour les partis qui, en l’espace de quelques semaines, se sont déplacés vers des positions de plus en plus radicales — du moins dans les discours. Beaucoup ont interprété ce virage comme un simple calcul électoral, dans le cadre d’une campagne pour les élections régionales qui va durée au cours des prochains mois. Il y a certainement du vrai, mais la stratégie semble plus subtile et plus à long terme. Avec les référendums sur le travail et sur la citoyenneté, les partis de la gauche institutionnelle ont compris qu’une part significative de l’abstention et du non-vote portait des revendications de justice économique et sociale qu’ils ne parviennent pas à capter électoralement. Pendant ce temps, le camp centriste est pratiquement asséché, presque entièrement déplacé vers la droite. Mais la désaffection envers les partis institutionnels est si profonde que les simples déclarations d’intention et les campagnes froides ne suffisent pas à ramener les gens aux urnes. Le centre-gauche, dans ses différentes déclinaisons, est donc contraint de courir derrière les phénomènes sociaux et d’essayer de s’y insérer comme un flanc institutionnel.
Cette tendance ouvre une phase ambivalente : d’un côté, des revendications issues de la base atteignent les canaux de la politique dominante ; de l’autre, le risque de récupération est bien réel. Il n’est pas simple de naviguer dans cette ambivalence, d’autant que les réalités militantes — y compris les plus structurées — ne disposent pas, pour la plupart, aujourd’hui des outils, des capacités ni du nombre suffisant pour favoriser l’organisation autonome de la grande spontanéité qui s’est déversée dans les rues. Dans une phase d’accélération de ce genre, tous ces éléments peuvent se construire rapidement, mais pour cela, il faut trouver des formes qui favorisent le protagonisme social et l’auto-organisation de l’intelligence collective. Quelles contre-institutions ce mouvement — ou celui qui pourrait venir — peut-il se donner ? C’est la question urgente qui, dans la ferveur de ces journées, a été justement mise de côté, mais qu’il faudra aborder pour donner continuité et profondeur au mouvement, sans qu’il soit réabsorbé dans les dynamiques institutionnelles.
4 – Dispositifs de disciplinement et rapports de force
Le mouvement « Bloquons tout » a remis en cause, en l’espace de deux semaines, de nombreux dispositifs de disciplinement que ce gouvernement, comme ceux qui l’ont précédé, avait mis en place pour contrer les luttes sociales. Face aux chiffres et à la puissance de la mobilisation, le fameux Décret Sécurité4 s’est dissous comme neige au soleil. Des dizaines de milliers de personnes ont pratiqué les blocages et les occupations de ports, d’autoroutes, de voies ferrées et d’aéroports, tandis que les préfectures et commissariats laissaient souvent faire — à la fois par impréparation face à l’ampleur de l’événement et pour éviter de lui donner encore plus d’ampleur. Le 3 octobre a ensuite marqué un autre tournant historique : pendant des décennies, le droit de grève des travailleurs et travailleuses a été entravé dans un ensemble de réglementations destinées à en neutraliser le plus possible l’efficacité. Le travail de démolition de ce droit s’est poursuivi même à des moments où l’outil de la grève mettait en cause les profits de filières spécifiques — comme celle de la logistique — sans pour autant remettre en question l’ensemble du système économique italien. Souvent, les syndicats confédéraux ont été complices de ces limitations progressives. Le 3 octobre a démontré que la grève est toujours légitime, indépendamment de ce que dit le garant, des menaces de réquisition, ou de la colère de Salvini. En deux semaines, ce mouvement a construit un rapport de force incroyable, même si, dans la rhétorique schizophrène du gouvernement, ces conquêtes sont présentées comme des concessions. La reconquête d’une plus grande liberté d’action politique pour les mouvements sociaux passe par là : par l’enracinement et le renforcement de ces rapports de force.
5 – Le cadre objectif
Dans la matinée d’hier, le Hamas a annoncé avoir accepté la première partie du plan Trump, celle concernant la libération des otages israéliens et le cessez-le-feu, tout en souhaitant discuter des points relatifs au retrait des forces armées israéliennes (IDF) de Gaza, à la démilitarisation de la résistance palestinienne et au « protectorat » américain sur la bande.
De retour dans son pays, Netanyahou continue d’affirmer que l’armée israélienne restera dans la bande, tandis que les ministres les plus extrémistes de son gouvernement ne cessent de saper l’accord de paix. Toujours hier, Trump a reconnu dans l’après-midi que « Bibi est allé trop loin » et qu’il a risqué d’isoler Israël sur la scène internationale. C’est un signe que la mobilisation de l’opinion publique internationale a pesé — et pas qu’un peu — sur le contexte des négociations. Il est difficile de prévoir ce qui peut se passer dans les prochains jours : la guerre pourrait reprendre immédiatement après la libération des prisonniers, ou bien connaître une période de refroidissement plus ou moins longue. Les perspectives de création d’un État palestinien sur le territoire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza semblent, pour l’instant, très limitées — tout comme celles d’un processus de décolonisation de la société israélienne semblable à celui survenu en Afrique du Sud. Sans s’attaquer à la racine du projet sioniste, les chances d’une paix durable en Palestine sont proches de zéro.
La perspective d’un cessez-le-feu effectif et durable dépend aussi de la pression politique qui pourra être maintenue sur Israël. Il est naturel — et physiologique — qu’une éventuelle trêve ait un impact sur la participation aux mobilisations, mais il sera essentiel de maintenir l’attention sur Gaza et sur les crimes de guerre, sur le génocide commis par Israël au cours de ces deux dernières années. Beaucoup de gouvernements, y compris le nôtre, voient dans cette éclaircie une occasion de normaliser leurs relations avec Israël et d’essayer de passer l’éponge sur le massacre impuni du peuple palestinien. Nous ne pouvons pas le permettre.
Il ne faut pas oublier non plus que, ces dernières semaines, les vents de guerre à l’est soufflent de plus en plus fort. Alors que le regard de l’opinion publique reste fixé sur Gaza, le risque d’une escalade militaire devient concret. La militarisation de l’Union européenne progresse à un rythme effréné, et les perspectives d’un refroidissement du conflit semblent de plus en plus lointaines. On ne peut pas exclure de nouvelles accélérations du désordre mondial. Même ce qui se passe en Amérique latine, avec l’agressivité américaine envers le Venezuela — déguisée en « guerre contre la drogue » — n’augure rien de bon.
6 – Conclusions
Nous en arrivons à la journée d’hier, 4 octobre, rendez-vous lancé par les associations palestiniennes en Italie, qui s’est inscrite, avec un calendrier favorable, comme le point culminant des deux semaines précédentes, allant de la grève du 22 à celle du 3.
Le premier élément à souligner est la participation massive, littéralement océanique : le parcours lui-même n’a pas réussi à contenir physiquement le nombre de personnes présentes.
Cet aspect peut nous offrir un point de réflexion sur les possibilités concrètes de se tenir dans la rue.
Le serpentin long de plusieurs kilomètres s’est déroulé dans les artères de Rome, incapables de le contenir ; à la fin du cortège, des jeunes ont pris certaines rues latérales pour rejoindre d’autres lieux de la ville, et cette tentative s’est heurtée à une réponse rapide de la partie adverse : deux encerclements ont été formés à la suite de jets de canon à eau et de gaz lacrymogènes, enfermant quelques centaines de personnes, ensuite identifiées et relâchées.
En parallèle, dans d’autres points de la ville, il y a eu des charges policières accompagnées d’un lancement massif de gaz lacrymogènes ; une voiture de police a pris feu, et jusque tard dans la soirée, des affrontements se sont succédé dans plusieurs zones.
Il semblerait pour le moment que sur les 12 interpellés, on compte 2 arrestations.
Les journaux ont relancé la narration resséssée de la division entre « bons et méchants », tentant de criminaliser et de fragmenter le mouvement, en omettant délibérément la réalité de ce qui s’était produit la veille et la forte charge conflictuelle qui avait caractérisé toutes les places lors de la journée de grève générale, de manière transversale. « Bloquer », nous l’avons dit collectivement, du nord au sud, a pris ces dernières semaines une valeur concrète. Les dockers, de Gênes à Livourne, de Trieste à d’autres ports, nous l’ont enseigné : bloquer, cela signifie interrompre les flux qui alimentent une économie de guerre et financent le génocide en Palestine. Une ritualité a été brisée grâce au choix de toutes les personnes descendues dans la rue qui ont réellement mis à disposition d’eux-mêmes, de leur vie, de leur temps, afin d’être impactant, afin de pratiquer efficacement l’objectif de ne pas être complices du gouvernement d’Israël ni des gouvernements occidentaux qui le soutiennent.
Comme on l’a déjà dit, se pose maintenant la question de la continuité, à la lumière à la fois des transformations générales en cours et des formes que prendra le mouvement à l’intérieur et au-delà de ses dimensions organisées.
Certains éléments susceptibles de constituer une proposition devront tenir compte de la diffusion territoriale géographique qui a contribué à la réussite et à la tenue de ces deux semaines, et donc de la nécessité d’en alimenter la diffusion ; du rôle des médias, qui ont permis de massifier la composition sociale du mouvement ; de la nécessité de continuer à construire des blocages réels, accompagnés de l’ouverture d’espaces de prise de parole capables d’expliciter la profonde signification politique de ce qui est en train de se mettre en mouvement.
Une fenêtre éblouissante a déchiré la normalité ; faire de l’exceptionnalité de ce moment une nouvelle normalité est un pari qu’on ne peut pas se permettre de fuir.



- Le mouvement des Forconi a éclaté en 2013 lancé initialement par des chauffeurs autoroutiers siciliens et proches de la droite contre la fiscalité et l’État plus globalement. Le mouvement s’est étendu à d’autres secteurs sociaux (agriculteurs, ouvriers, marchands ambulants, etc.) sur toute la péninsule de façon peu structurée. Le manifestants ont procédé principalement à des blocages autoroutiers, routiers et des ronds-points. C’est une des premières fois où la composition mobilisée ne se rattachait pas à une ideologie précise, mais plutôt ambiguë. Les mots d’ordre des forconi se concentraient sur des revendications liées aux conditions materielles de vie et pas du tout idéalistes… Pour en savoir en plus : https://www.infoaut.org/bisogni/impressioni-di-dicembre ↩︎
- Équivalent du Pass sanitaire en France pendant le Covid ↩︎
- La date du 22 septembre avait été choisie par les syndicats de lutte comme première grande date nationale de «Bloquons tout» avec un appel à la grève. ↩︎
- Le Décret Sécurité à été voté en juin 2025 et fait passer des dispositions d’urgence en matière de sécurité publique telles que l’anti-terrorisme, plus de tutelle des forces de l’ordre, des dispositions plus strictes et des peines plus dures en matière de gestion de l’ordre public. Par exemple le décret alourdit les peines pour les blocages routiers, pour interruption de services publics (c’est-à-dire la grève). Cette loi a aussi été surnommée ‘loi contre les mouvements écologistes’ car ils ont fait de ces pratiques de désoibeissance civile leur forme de lutte privilegié (mais pas que). ↩︎
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
blocchiamo tuttoBLOQUONS TOUTgazamanifestazione nazionale 4 ottobremovimento socialepalestinaromatraduzione